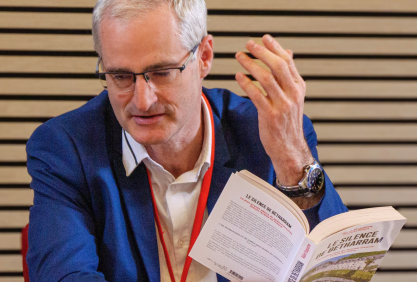Libérer la parole de l'enfant
« Les violences sont massives, mais les enfants restent très seuls avec ce qu’ils vivent. » Le constat est dur, mais Muriel Salmona connaît le poids des mots. Psychiatre spécialisée en traumatologie, elle préside l’association Mémoire traumatique et victimologie et fait partie de la commission d’enquête indépendante sur l’affaire de Notre-Dame de Bétharram. « Un enfant sur quatre subit des violences physiques, un sur trois des violences psychologiques, une fille sur cinq et un garçon sur treize des violences sexuelles », énonce-t-elle. La parole de l’enfant est un facteur clé pour mettre fin aux violences et le protéger. Comment l’aider à mettre les mots sur ce qu’il vit ? Comment réagir lorsqu’il se confie ?
Repérer les signes
Des signaux peuvent alerter. Est-ce que l’enfant a modifié son attitude ? Est-ce qu’il est frustré, violent envers lui-même ou autrui ? Ses résultats scolaires sont-ils en chute ? Développe-t-il des phobies ? Est-ce qu’il est agressif, renfermé, triste ? Scarifications, fugues, vols dans un commerce, troubles alimentaires ou du sommeil sont d’autres manifestations possibles. « Si on voit que différents éléments apparaissent, on peut lui poser des questions pour ouvrir la porte, montrer qu’on s’inquiète », conseille Gilles Lazimi, médecin généraliste au Centre de santé, à Romainville (93) et coordinateur de nombreuses campagnes nationales contre les violences envers les enfants et les femmes.
« Mais parfois, il n’y a rien de visible, car l’enfant est traumatisé, dissocié, et peut paraître calme, explique Muriel Salmona. Si l’on attend des signaux, on passe à côté, car parmi les conséquences traumatiques universelles, il y a la paralysie, l’anesthésie émotionnelle : l’enfant ne réagit pas. Et ce n’est absolument pas de sa faute. » Selon les recommandations de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), il faudrait régulièrement créer pour l’enfant des occasions de parler des violences, même en l’absence de symptômes.
Créer de l'espace pour la parole
« L’écoute de l’enfant demande une grande délicatesse et disponibilité psychique de l’adulte. Il doit éviter les réactions défensives – comme prendre un visage effrayé, car l’enfant peut croire que c’est lui qui est effrayant ou dégoûtant – ou les interrogatoires trop intrusifs », prévientHélène Romano, docteure en psychopathologie, spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences ou de maltraitance.
Même s’il est difficile d’entendre qu’un enfant a subi des violences, il ne faut pas l’interrompre ni mener un interrogatoire policier. Pour Hélène Romano, « écouter, ce n’est pas auditionner l’enfant. Trop de questions peuvent parasiter son témoignage ».
« On peut libérer la parole de l’enfant en utilisant nos ressentis d’adulte comme un levier relationnel », poursuit-elle. On peut par exemple dire : “J’ai remarqué que tu te fâches tout le temps. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi ?”, “Je vois que tu as changé depuis quelque temps. Est-ce qu’il y a quelque chose qui ne va pas ?” ou encore “Est-ce que tu dors moins bien en ce moment ?” L’enfant doit comprendre que c’est à lui de mettre des mots. On fait l’archéologue pour aider l’enfant à nommer ce qu’il ressent », résume la spécialiste. Elle pointe également le paradoxe de la situation, car très souvent « la personne maltraitante obtient le silence de l’enfant en lui disant par exemple : “Si tu parles, tu iras en foyer” ».
Pour faciliter la discussion, l’association Mémoire traumatique et victimologie a conçu le livret Quand on fait du mal, illustré par Claude Ponti, dont cent mille exemplairesont déjà été diffusés ces trois dernières années. « Ce support dit aux enfants ce qu’il est interdit aux adultes de leur faire, les aide à comprendre ce que sont les violences, leurs conséquences, et comment identifier des situations traumatiques perturbantes, décrit Muriel Salmona, co-autrice du texte. Trop souvent, les enfants se croient coupables, éprouvent de la honte : c’est un élément central de la stratégie des agresseurs. Ce livret est un guide pour eux, mais aussi pour les parents et les professionnels : il donne des repères pour recueillir la parole. »
Ce qui est certain, c’est qu’il ne faut jamais interroger l’enfant comme s’il était responsable. « Si un enfant dit : “Mon prof m’a hurlé dessus”, il ne faut pas lui répondre : “Qu’est-ce que tu avais fait ?’, mais lui dire qu’on le croit, qu’on est là pour lui », illustre Gilles Lazimi qui, en tant que président de l’association Stop VEO-Enfance sans violences, rappelle que les violences éducatives « ordinaires » représentent 75 % des maltraitances et sont souvent banalisées par des proverbes telles que « Qui aime bien châtie bien ». Pourtant, il ne faut pas minimiser les faits, met en garde le médecin : « Beaucoup de victimes de Bétharram ont pensé que les agissements qu’elles subissaient étaient normaux, faisant partie de la “terreur éducative” de l’établissement, et peut-être aussi des violences vécues à la maison*. » Prendre conscience des violences faites aux enfants relève d’une responsabilité collective et individuelle : chaque adulte peut être ce relais d’écoute de la parole et de protection dont les jeunes victimes ont besoin.
*La loi du 10 juillet 2019 a mis les choses au clair : « L'autorité parentales'exerce sans violences physiques ou psychologiques. » Le recours aux fessées, aux gifles, aux tirages d'oreille et à toutes les formes d'humiliations verbale ou psychologique (cri, menage, chantage, insulte, retrait d'affection, etc.) doit être banni.
Pourquoi trop d'adultes se taisent-ils ?
Hélène Romano, Docteure en psychopathologie
« Parfois, l’adulte ne réagit pas après avoir entendu une parole confiée par l’enfant parce que cela peut être une caisse de résonance par rapport à ce qu’il a lui-même vécu enfant. Alors il a des mécanismes de défense, en disant par exemple « Je connais ton papa, ton papa est gentil », « Ta maman t’a crié dessus parce que tu avais sans doute fait une bêtise ». L’adulte ainsi se protège.
Par ailleurs, les maltraitances et les violences réitérées sur un enfant sont à 98 % familiales, alors que les parents sont censés être les protecteurs. Donc, c’est psychologiquement plus économique de ne pas croire l’enfant. Sinon, toutes nos valeurs s’effondrent. Certains parents pensent à leur couple plutôt qu’au bien-être de l’enfant ou ils ont peur du qu’en dira-t-on. C’était le cas d’une maman dont la fille subissait des viols de son cousin. La première fois qu’elle a parlé à sa mère, elle avait 6 ans. Or, sa mère s’entendait très bien avec son frère, le père du garçon. Pour elle il était trop dangereux d’affronter les faits. Alors, elle a dit à sa fille : « Mais non, ce sont des jeux de papa-maman.» Résultat, le cousin a continué pendant cinq ans, jusqu’à ce qu’il y ait un signalement de l’école. La mère s’est écroulée. Elle n’avait pas pris la mesure de la gravité des faits, car elle craignait que sa famille explose. »
Ressources
- 119 - Allô Enfance en danger, numéro national gratuit, 24h/24, 7j/7.
- Quand on te fait du mal, livret de Sokhna Fall et Muriel Salmona, illustré par Claude Ponti, pour informer les jeunes enfants sur les violences et leurs conséquences, à télécharger gratuitement sur le site de l’association Mémoire traumatique et victimologie, accompagné d’un livret d’aide « pas à pas » pour les adultes.
- UAPED : les Unités d’accueil pédiatriques pour enfants en danger, dans les hôpitaux.
- Le site Stop VEO : informations sur les violences éducatives ordinaires (VEO) et outils pour changer les pratiques.
- Les Cercles de parents, animés par des infirmières puéricultrices, pour accompagner les parents et prévenir les VEO.
- Module de formation interactive et gratuite (30 min) : Protection de l’enfant contre les violences sexuelles.
À lire également
Découvrez tous les articles